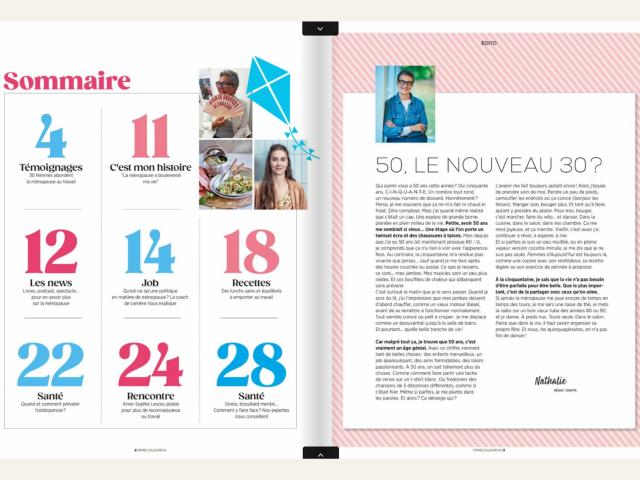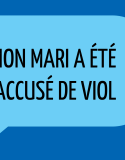Valérie, 55 ans: “Ancienne journaliste, je suis devenue prof de français”

Après sept semaines de vacances bien méritées, Valérie, 55 ans, professeure de français, reprend elle aussi, comme des milliers d’élèves, le chemin de l’école. Mais ce sera pour elle seulement sa 5e rentrée scolaire. Car c’est à 50 ans qu’elle s’est lancée dans l’enseignement.
Valérie, 55 ans, est plus que ravie de nous rencontrer pour parler de son nouveau métier: professeure de français en 5e et 6e secondaire (option comptabilité) à Bruxelles. Les médias, elle connaît: elle a été journaliste pendant de nombreuses années, avant d’être licenciée à 50 ans. “J’ai vécu une très grosse remise en question, confie-t-elle. Par rapport à moi-même et à mon travail, qui n’évoluait pas comme je le souhaitais. J’ai alors eu envie d’exercer un métier plus essentiel. Je me suis dit: Être prof de français, ça me plairait bien. La maîtrise de la langue, la littérature, la culture, les débats philosophiques… m’avaient toujours passionnée. J’ai postulé sur le site Enseignement.be. Il suffisait de télécharger ses diplômes –j’avais étudié l’Histoire de l’art à l’université. 2 jours plus tard, j’étais engagée! Je n’avais pourtant pas d’agrégation, et donc aucune expérience pédagogique –j’ai suivi la formation un peu plus tard en cours du soir.”
Le soutien d’une véritable corporation
Valérie ne choisit pas sa première école: elle atterrit dans un athénée professionnel à indice socio-économique très faible, avec des élèves “pas faciles à gérer’” “Une vraie claque, dit-elle, d’autant qu’on était en plein Covid et que je devais porter un masque pour donner cours. On dit que 40% des professeurs arrêtent avant 4 ans: j’ai compris pourquoi. Heureusement, dans cette école –et la suivante– j’ai pu compter à chaque fois sur des mentors formidables. En entrant dans l’enseignement, j’ai intégré une véritable corporation. Mes collègues m’ont soutenue et m’ont appris à m’adapter à tout. Sans eux, je n’aurais probablement pas tenu…”
“J’ai parfois été découragée”
Au début, Valérie se lance dans le métier, pleine d’énergie, ayant à cœur de pouvoir transmettre sa passion de la langue et de la culture. “En tant qu’ancienne journaliste, j’étais prête à répondre aux questions, à m’intéresser aux élèves… Mais j’ai dû calmer mes ardeurs. Être prof, c’est du stand-up, 7 heures d’affilée.” Premier conseil qu’on lui donne : “Ne dépense pas toute ton énergie dès la première heure!” “J’ai appris à rester debout longtemps (une fois assise, on perd toute autorité), à ménager ma voix (je me suis retrouvée plusieurs fois aphone) et à varier mes approches (participation active, travail en groupe…).”
Surtout, elle doit faire face au manque de réceptivité de ses élèves –ils sont en option compatibilité: le cours de français n’est pas leur priorité– et à l’absentéisme. Principalement en 5e, car il n’y a pas de redoublement. “Il m’est arrivé d’être découragée, car j’avais seulement 4 ou 5 élèves présents sur 24, et de me demander comment j’allais terminer mon programme et rattraper les lacunes en 6e –les bases grammaticales sont loin d’être acquises, il faut dire que j’ai seulement 2 élèves dont le français est la langue maternelle. Lors de l’examen oral, seuls 5 étaient présents, les autres étant absent sans certificat médical. Quand je les ai revus la semaine suivante, ils m’ont dit: ‘Mais Madame, de toute façon, on sait qu’on passe en 6e.’”
Être prof, c’est du stand-up, 7 heures d’affilée
Valérie, 55 ans
60 h/semaine pour un prof débutant
Autre difficulté: la charge administrative. En 5 ans, Valérie constate qu’elle a explosé: secrétariat, paperasse, réunions pédagogiques… “On dit que les profs donnent 20 heures de cours par semaine. C’est faux: on en preste 38 à l’école, sans compter les préparations de cours et les corrections le soir à la maison. Pour un prof débutant, cela peut monter à 60 heures/semaine. Certes, on termine à 16h et on a de belles vacances. Mais à 16 h, une sieste est une nécessité absolue. Quant aux vacances, elles servent juste à recharger nos batteries.” Valérie regrette le prof-bashing, cette tendance à critiquer publiquement les profs qu’on voit trop souvent sur les réseaux sociaux. “On y sous-entend que les professeurs ne font pas grand-chose. C’est tellement loin d’être le cas!”
Des compétences journalistiques bien utiles
Valérie l’affirme: ce qu’elle a appris dans sa première carrière de journaliste est loin d’être perdu. “Faire des recherches, synthétiser des documents, vérifier les sources, parler face à une caméra ou un public… Ces compétences me servent tous les jours en tant que prof. J’ai animé des ateliers d’écriture aussi (Valérie est également écrivaine, ndlr), j’aime faire écrire mes élèves, inviter des écrivains en classe… Les élèves adorent savoir que j’ai été journaliste, que j’ai interviewé telle ou telle célébrité. Ils trouvent cela motivant. Certains veulent devenir journaliste d’ailleurs.”
De nombreux parents semblent estimer que, leur enfant étant (presque) majeur, il n’est plus nécessaire de s’impliquer. Or, ils ont encore vraiment besoin de leur soutien.
Ils ont perdu beaucoup d’illusions
Les élèves de Valérie ont, pour la plupart,17-18 ans. “Quand j’entends mes collègues de 1re ou 2e secondaire, dit-elle, je me réjouis d’échapper aux problèmes de gestion des émotions ou des hormones des jeunes ados. Les miens sont un peu plus matures. J’ai moins de problème de discipline –même si j’ai connu quelques rares cas de violence. Peut-être que vu mon âge, je bénéfice d’une autorité naturelle…”
Valérie le sent: certains de ses jeunes ont été fragilisés par le confinement. Ils ont beaucoup souffert du manque de contact et de solidarité, et y ont perdu beaucoup de leurs illusions. Sans compter que certains n’ont quasiment pas eu cours de français pendant un an.
“Ce que je regrette aussi, ajoute-t-elle, c’est l’absence des parents. Lors des réunions de parents, j’attends parfois 3 heures sans voir personne. Sans doute estiment-ils que, leur enfant étant (presque) majeur, il n’est plus nécessaire de s’impliquer. Mais c’est une erreur: moi, je sais à quel point ils ont encore besoin du soutien de leurs parents.”
On marche parfois sur des œufs
Par contre, ce qui remplit Valérie de joie dans son nouveau métier, c’est lorsqu’un élève s’émerveille après un livre, un témoignage ou une visite de musée –des activités dont ils n’ont pas forcément l’habitude. “La littérature permet d’ouvrir à des questions existentielles: les stéréotypes, le déterminisme, l’égalité des genres… même s’il faut choisir les lectures avec prudence, car les débats peuvent très vite s’enflammer. J’introduis souvent des autrices féministes dans mon programme –la liberté pédagogique me le permet. Vu la multiculturalité de mes classes –j’ai des élèves qui viennent de partout: Maghreb, Europe de l’Est, Afghanistan, Syrie…– le sujet est délicat. On marche sur des œufs, surtout quand on sait que certains garçons voient d’un mauvais œil le fait que je sois une femme et que certaines filles refusent de s’asseoir à côté d’un garçon.”
Ma plus grande victoire
Mais au fil de l’année, elle constate que le regard des uns et des autres évolue, et le prend comme une victoire personnelle. “Le jour où j’ai reçu un message d’une élève, un an après son départ, me disant qu’elle repensait à Simone de Beauvoir et préférait faire des études pour être indépendante plutôt que de se marier tout de suite, j’ai compris l’importance de mon rôle.”
Et l’enrichissement est réciproque. “Les élèves me confient leurs émotions, leur histoire, leur façon de voir le monde. Une classe est un microcosme de vies, d’intime. Certains ont quitté leur pays pour pouvoir survivre, d’autres n’ont pas assez à manger ou travaillent la nuit… Leurs récits me font réfléchir, me poussent à m’adapter. Je le faisais déjà beaucoup en tant que journaliste, mais c’est encore plus le cas aujourd’hui, car je me retrouve face à 24 élèves et donc 24 cerveaux différents. C’est un métier qui invite vraiment à se remettre continuellement en question.”
Un métier physiquement difficile
Bref, Valérie ne regrette pas une seconde son changement d’orientation. “Je suis bien où je suis. Je me vois continuer comme prof jusqu’à 67 ans.” Sa seule crainte? Que son corps ne suive pas. “Je vais sans doute acquérir plus de techniques pour capter l’attention des élèves et les rendre plus autonomes dans leur travail, mais professeur est un métier physiquement difficile. Il faudra que je pratique beaucoup de sport pour être sûre de tenir le coup!”
Vous aimerez aussi:
Recettes, mode, déco, sexo, astro: suivez nos actus sur Facebook et Instagram. En exclu: nos derniers articles via mail.