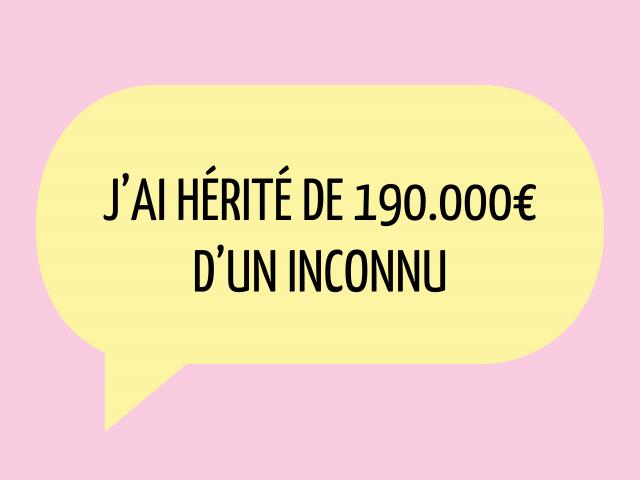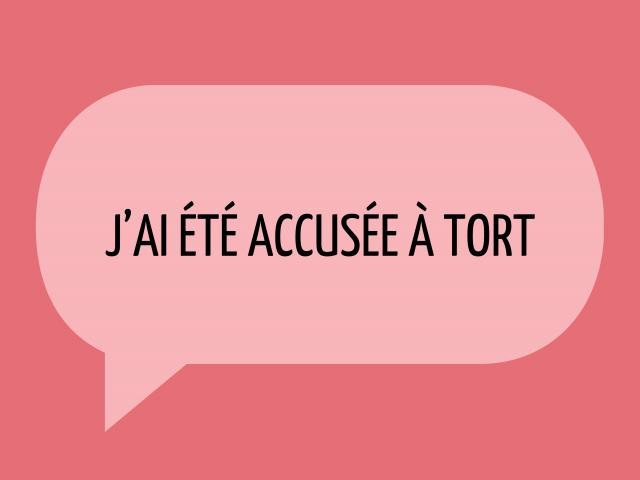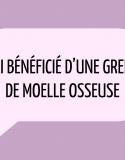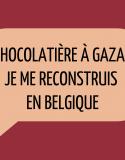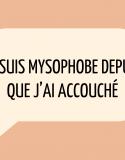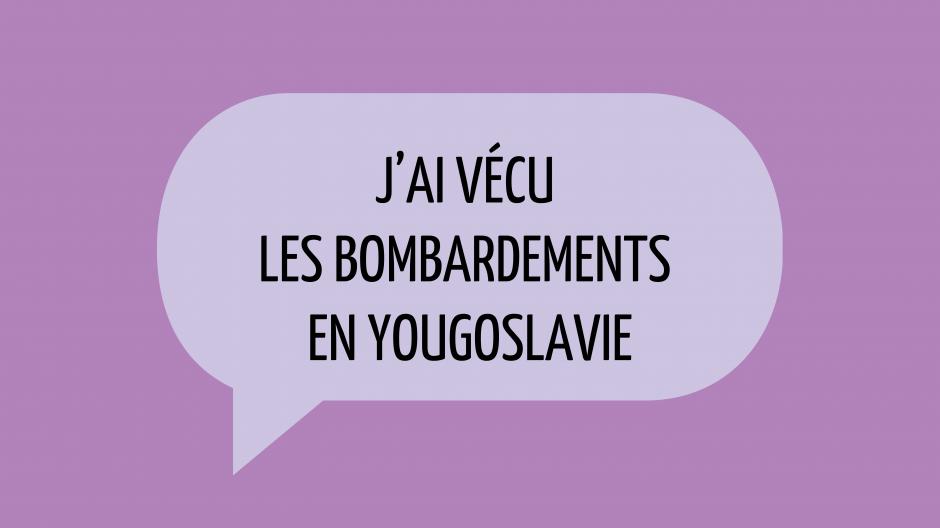
Anne Morelli: “J’ai vécu les bombardements en Yougoslavie”
Anne Morelli, docteure en histoire contemporaine et professeure honoraire à l’Université libre de Bruxelles, a participé en 1999 à une mission civile en Yougoslavie. Une immersion brutale dans la guerre qui a bouleversé son regard sur le monde.
“J’avais 50 ans, j’étais enseignante à l’ULB et mère de 4 enfants lorsqu’on m’a proposé de rejoindre une mission de paix en Yougoslavie. Nous étions une dizaine de représentants de la société civile belge (une femme de lettres, un sculpteur, un journaliste…) chargés d’enquêter sur les conditions de vie des civils yougoslaves frappés d’embargo et de relayer, en Belgique, la réalité qu’ils enduraient. Avant de partir, j’étais loin d’imaginer l’ampleur de la violence à laquelle j’allais être confrontée. À peine avions-nous atterri dans le pays que la situation a basculé: la Yougoslavie est devenue la cible des bombardements de l’OTAN (une campagne lancée sans mandat de l’ONU!), menée notamment par des F-16 belges.”
Dans la peau d’une reporter de guerre
“Pendant près de 3 semaines, nous avons sillonné le pays du nord au sud, découvrant un quotidien marqué par les abris de nuit, les sirènes et les vagues de bombardements. Quel choc de voir des bâtiments en ruine, des corps sous les décombres et des langes de bébés parmi les débris! Entendre ce genre de nouvelles à la radio ou les lire dans un journal ne ressemble en rien à l’expérience de les vivre réellement. C’est insoutenable, surtout quand on sait que certaines de ces bombes sont larguées par nos avions belges.
Je me souviens du bombardement d’un hôpital, quasiment sous mes yeux. Une infirmière blessée avait dû être amputée d’une jambe. J’étais restée longtemps avec elle. Elle m’avait regardée droit dans les yeux et m’avait demandé: ‘Pourquoi votre pays m’en veut? Qu’ai-je fait pour mériter ça?’ Le matin du bombardement, elle ne devait normalement pas travailler, mais avait couru vers l’hôpital, espérant pouvoir s’y rendre utile. Elle me disait avoir toujours soigné avec le même dévouement les malades serbes, croates, albanais…Ses mots résonnent encore en moi.
Une infirmière blessée m’a demandé: ‘Pourquoi votre pays m’en veut? Qu’ai-je fait pour mériter ça?’
Je me rappelle aussi, comme si c’était hier, de ce petit garçon, traumatisé, qui venait de perdre son grand-père, son oncle et son chien dans le bombardement. Quand je l’ai quitté, il jouait, tout seul, en silence avec un morceau de bois. Il fabriquait un avion pour, disait-il, ‘attaquer les méchants qui bombardent’.”
Témoigner de l’horreur
“En Yougoslavie, j’étais reconnue comme reporter de guerre. Mon rôle était de rendre compte, depuis le terrain, de cette réalité insoutenable. Je restais en contact régulier avec des médias belges, à qui j’envoyais des articles, des témoignages et des photos par fax, espérant modifier leur vision. Il s’agissait de faire prendre conscience, en contrepartie de l’opinion générale en Belgique, favorable à ces bombardements, de ce qu’ils signifiaient concrètement. Car derrière chaque frappe, il y avait des vies brisées, des familles dévastées et des douleurs bien réelles. Il me tenait à cœur de photographier ce que nos médias ne montraient pas. J’avais notamment pris un cliché poignant d’un petit garçon près de son père, le ventre bandé d’un grand pansement, après avoir été frappé par un éclat d’obus. Ces images resteront gravées dans ma mémoire pour toujours.”
Lire aussi: 12 podcasts en français sur les faits divers
Vivre cachés
“Avec les autres membres de la mission de paix, nous étions logés à Belgrade dans un hôtel, mais dans la plus stricte discrétion. On nous répétait sans cesse de ne révéler notre présence dans cet hôtel à personne. Un jour, j’ai remarqué une chambre voisine étrangement éclairée, où avaient lieu des va-et-vient incessants. J’ai compris, plus tard, que cette pièce abritait les journalistes yougoslaves ayant survécu au bombardement, le 23 avril 1999, du siège de la télévision d’État. Une attaque qui avait coûté la vie à 15 d’entre eux.
Moins de 6 heures après le bombardement, les écrans s’étaient remis à diffuser, car des survivants s’étaient réfugiés là et continuaient à informer, clandestinement, juste à côté de ma chambre, faisant croire à la poursuite ‘normale’ des émissions. Il aurait été extrêmement dangereux (pour eux comme pour nous) qu’on arrive à les localiser!”
Mieux vaut sous les bombes que divorcée!
“Seul mon mari était au courant des raisons de mon départ en Yougoslavie. Mes enfants étaient encore trop petits pour comprendre. La plus jeune avait 11 ans. Ils pensaient que mon voyage était, comme souvent, lié à mes enseignements. Et je n’avais rien dit au reste de la famille. À l’époque, les moyens de communication n’étaient pas ceux d’aujourd’hui. Nous sommes restés quasiment sans nouvelles réciproques pendant tout mon séjour là-bas.
À ma belle-mère, que nous visitions chaque samedi, j’avais simplement annoncé que je ne pourrais pas venir la voir durant les prochaines semaines. Elle ignorait les raisons de mon absence, mais un jour qu’elle écoutait la radio, elle m’a entendue en interview en direct sur RTL depuis Belgrade! Curieusement, cela l’a rassurée: elle avait imaginé qu’il y avait une mésentente dans mon couple et que je voulais divorcer. Pour elle, mieux valait, semble-t-il, être sous les bombes que sur le point de quitter mon mari!”
Justifier l’injustifiable
“À mon retour en Belgique, je n’étais plus la même. Cette confrontation brutale à la guerre a été un véritable déclic. Ce que j’avais vu, entendu, ressenti ne me quittait plus. Mais au-delà de l’émotion, je voulais comprendre. Comment l’opinion publique belge avait-elle pu soutenir une guerre dont elle ignorait presque tout? Comment peut-on manipuler une population au point de lui faire accepter que nos avions belges participent à de tels bombardements?

À l’époque, je donnais à un grand nombre d’étudiants de première année un cours intitulé Critique historique appliquée aux médias modernes. Après cette mission, mes recherches ont pris un nouveau tournant. J’ai commencé à étudier de près les mécanismes de la propagande de guerre. Ils sont toujours semblables: l’opinion publique doit toujours croire que nous sommes attaqués et en droit de nous défendre. Que l’autre camp est seul à pratiquer des atrocités (notre camp jamais!) et qu’il est dirigé par un fou maléfique. Et si vous émettez des réserves quant à cette narration, vous serez tout de suite taxé d’agent de l’ennemi.
À mon retour en Belgique, je n’étais plus la même. Cette confrontation brutale à la guerre a été un déclic.
Ce sujet m’avait toujours passionnée, mais j’ai pu l’étoffer, à partir de l’expérience yougoslave, de nombreux exemples couvrant tout le 20e siècle. De ces travaux est né en 2001, un petit livre d’abord destiné à mes étudiants, qui est devenu, au fil des années, un ouvrage de référence. Il a été réédité et augmenté plusieurs fois. Il est aujourd’hui traduit en 8 langues, dont le japonais et l’espéranto!”
Rester critique
“Depuis cette expérience marquante en Yougoslavie, je reste extrêmement vigilante. Aujourd’hui encore, mes recherches sur la propagande de guerre restent cruellement d’actualité. Que ce soit en Ukraine, à Gaza ou ailleurs, je reconnais les mêmes mécanismes de propagande. On retrouve les mêmes récits binaires: d’un côté, notre camp, le ‘camp du bien”, de l’autre un ennemi à abattre qui est déshumanisé. Mais il ne faut pas oublier tout ce qu’il y a derrière des bombardements et une guerre. Sous les bombes, il y a toujours des civils. Des innocents qui ne sont en rien responsables de ce qui arrive. Je ne suis jamais aussi contente que lorsqu’un ancien étudiant m’envoie un message me disant: ‘Hier, au journal télévisé, j’ai vite reconnu le principe n°4 que vous nous avez enseigné.’ J’espère avoir semé parmi mes étudiants un regard critique qui leur permette de questionner, tout au long de leur vie, les discours officiels.”
Texte: Gwendoline Cuvelier
Le livre pour tout comprendre
Principes élémentaires de propagande de guerre – Utilisables en cas de guerre chaude, froide ou tiède, Anne Morelli, éd. Aden Belgique
Vous aimerez aussi:
Recettes, mode, déco, sexo, astro: suivez nos actus sur Facebook et Instagram. En exclu: nos derniers articles via mail.